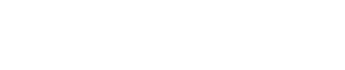EXISTE-T-IL DES FACTEURS AGGRAVANT LA SOUFFRANCE DES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES AU SEIN DE NOS ÉGLISES ?
Paul Efona
Introduction
Le 03 septembre 2019, à l’occasion de l’ouverture du Grenelle contre les violences conjugales, le Premier ministre, Edouard PHILIPPE évoquait le drame des victimes, majoritairement des femmes, violentées et tuées parce que femmes :
« L’impunité de frapper leur femme ou leur compagne, une fois, puis plusieurs fois, puis de la violenter systématiquement pour ce qu’elle fait ou ce qu’elle ne fait pas, pour ce qu’elle dit ou ce qu’elle ne dit pas, pour ce qu’elle est ou ce qu’elle n’est pas. La violenter, la terroriser et parfois la tuer parce qu’elle représente une altérité. Le propre d’une altérité, c’est d’avoir une volonté, une liberté qui ne coïncident pas toujours avec la nôtre. Et certains hommes ne le supportent pas. Je ne croyais pas avoir à dire cette phrase un jour, dans une grande démocratie comme la France, mais certains hommes n’arrivent pas encore à supporter que leur compagne existe, autrement que « pour eux ». Si bien qu’aujourd’hui, dans notre pays, des femmes, nos concitoyennes, meurent étranglées, poignardées, brûlées vives, rouées de coups. Tous les deux ou trois jours. Parfois sous les yeux de leurs enfants, parfois en pleine rue. Elles meurent en se jetant par la fenêtre, en serrant leur bébé dans leurs bras, pour échapper à leur conjoint. Depuis des siècles, ces femmes sont ensevelies sous notre indifférence, notre déni, notre incurie, notre machisme séculaire, notre incapacité à regarder cette horreur en face. »
Au-delà du constat, ces propos esquissent sommairement une analyse des facteurs ayant constitué un terreau favorable à ces violences : indifférence, déni, machisme séculaire, impunité, la liste n’est certainement pas exhaustive.
Les Églises, heureusement bien que tardivement, prennent conscience que ces drames se vivent aussi en leur sein, et peut-être plus qu’on ne veut le voir et le dire. Il y a même des facteurs aggravant la souffrance des victimes. Notre réflexion s’inscrit surtout dans le contexte des Églises évangéliques caractérisées, entre autres, par un biblicisme teinté (dans certains milieux) d’un littéralisme étriqué. Ainsi par exemple, des enseignements sur la sujétion de la femme, sa soumission en toute chose à son mari, y compris à supporter ses coups ou son machisme, sa disqualification à enseigner au sein de l’assemblée, etc. trouvent en divers endroits une légitimation biblique. Le présent article, sans prétendre à l’exhaustivité, propose d’explorer quelques pistes pour comprendre comment des idéaux, des discours ou des pratiques pastorales sont des facteurs d’aggravation de la souffrance des victimes de violences conjugales au sein des Églises.
1. L’idéalisation du mariage et du « couple chrétien »
Historiquement, on inscrit à l’actif du protestantisme d’avoir redonné au mariage ses lettres de noblesse. En premier lieu, en l’émancipant d’une vision du célibat valorisé comme idéal de vie pour ceux qui veulent servir pleinement le Christ ; et en second lieu, en niant sa dimension sacramentelle, et donc en quelque sorte ce qui garantissait l’irréversibilité, voire la sacralité d’un tel engagement. En resituant le mariage dans l’ordre créationnel, les Réformateurs ont voulu rappeler au moins trois vérités importantes dans une compréhension protestante du mariage : d’abord la bonté originelle de celui-ci comme don de Dieu à l’homme et à la femme ; ensuite, dans ce cadre, le bonheur légitime de l’union sexuelle (plaisir et intempérance assumés) comme élément constitutif du lien conjugal lui-même ; et enfin le refus de la « sacramentalité » du mariage impliquant, d’une part, que cette institution est avant tout une affaire civile déléguée à l’autorité du magistrat, et d’autre part, que ce lien, en principe pour la vie, peut être en pratique profondément altéré, à un point tel que sa dissolution n’en devient qu’un moindre mal.
A partir de cet arrière-plan, mais surtout des invitations bibliques, il n’est pas surprenant que nos Églises valorisent l’engagement conjugal institué dans le cadre du mariage. Pour être plus exact, ajoutons que l’idéal du mariage en milieu chrétien est la formation du « couple chrétien », c’est-à-dire d’un homme et d’une femme ayant comme socle commun la foi chrétienne. Le problème, nous semble-t-il, tient moins à la valorisation de ce modèle qu’au glissement qui s’effectue souvent dans la direction d’une idéalisation du « couple chrétien » érigé, à priori, en couple modèle.
Dans nos assemblées, tout se passe comme s’il suffisait que les conjoints soient chrétiens pour que leur foyer soit un lieu de respect, de sécurité, de soutien, de bienveillance et d’épanouissement mutuel. Une telle idéalisation devient alors une croyance non seulement naïve, mais dangereuse. Naïve parce qu’elle semble ignorer les heurts inhérents à toute relation, et qu’elle suppose trop facilement qu’il suffit de croire ensemble pour construire ensemble un projet commun. Dangereuse, parce qu’elle renforce le refoulement de l’expression des souffrances qui s’invitent aussi dans le foyer des croyants. Nous devons avoir la lucidité avec laquelle Eric Fuchs, professeur honoraire d’éthique à la Faculté de théologie protestante de l’Université de Genève, articulait dans un même propos la beauté de la promesse fondatrice du couple et le risque de l’aliénation de l’autre :
« Le couple humain est porteur d’une triple promesse : être pour l’homme et la femme, l’un par l’autre, le lieu d’une effectuation de la liberté, de la fidélité, et de la conjugalité. Que, par conséquent, il court le risque d’un triple échec : devenir pour l’homme et la femme, l’un par l’autre, le lieu de l’expérience mortelle de l’enlisement, du mensonge et de l’aliénation. »
S’il est légitime d’espérer le meilleur pour des conjoints, il est dangereux que nos représentations du couple chrétien idéalisé, nous enferment dans une sorte de déni de la réalité des souffrances conjugales et des abus auxquels certaines victimes peuvent être exposées. Celles-ci voient souvent les promesses de départ se transformer en cauchemar épouvantable et souffrent en silence. Nous savons que les maltraitances au sein du foyer sont généralement cachées. D’une part parce qu’elles surviennent dans la sphère privée, et d’autre part, parce que les femmes sont écrasées sous le poids de la honte et de la culpabilité. Certaines considèrent même qu’elles méritent de subir ces sévices, qu’elles sont responsables de l’échec de leur ménage.
Dans quelques milieux, lorsque le mari n’est pas chrétien, il n’est pas rare que l’on suggère aux épouses l’idée que c’est un juste retour de bâton, un juste salaire du péché, que mérite celle qui s’est mise « sous un joug étranger » (Gal 5,1) en choisissant de faire alliance avec un incroyant, de former avec lui un attelage disparate (2 Co 6,14). De tels discours ne sont pas acceptables, ni sur un plan théologique parce que les données bibliques sont plus complexes, ni sur un plan pastoral parce qu’on ne peut pas accompagner une femme maltraitée en considérant qu’elle est responsable des sévices qu’elle endure.
La survalorisation de l’idéal chrétien du foyer amène aussi des responsables à placer le couple comme valeur absolue au-dessus de l’individu. Cela risque de conduire à une disqualification légaliste du divorce. Dans cette perspective, même dans le cas des agressions conjugales, on a du mal à envisager le divorce comme une mesure nécessaire pour protéger une victime des brutalités qu’elle subit. L’accompagnement pastoral proposé est unidirectionnel, orienté uniquement vers le sauvetage du couple à tout prix. On encourage alors l’épouse en souffrance à « porter sa croix », à « combattre le bon combat de la foi », car qui sait si par sa persévérance et son exemplarité elle ne « gagnera » pas son tortionnaire ? On a parlé de « syndrome missionnaire » comme il y a un syndrome de Stockholm, mais ici, la femme reste avec son bourreau pour le « gagner à Christ ».
Dans nos assemblées, où les liens relationnels sont aussi significatifs que dans une famille, la peur de ne pas être comprise, d’être jugée, de mettre à mal certaines relations (amis communs dans l’église), de faire du tort à la communauté (on est soucieux de l’image de celle-ci), rend encore plus difficile la situation des épouses, fortement culpabilisées de vouloir se séparer. Nous voyons donc que l’idéalisation du « couple chrétien », quand elle ne confine pas au déni de la souffrance conjugale, contribue à isoler davantage les femmes qui n’auront d’autre choix que d’endurer en silence.
2. Une certaine culture du silence
Les révélations successives des agressions sexuelles sur mineurs et sur des religieuses commis par certains prêtres de l’église catholique ont conduit, entre autres, cette dernière à reconnaître au sein de l’institution une culture du silence devenue mortifère pour les personnes agressées. Ce faisant, elle s’est couramment montrée davantage soucieuse de sa réputation et de la protection de son clergé, et moins préoccupée par la douleur des victimes ravagées par ces agressions. Oserons-nous admettre que les assemblées évangéliques, elles aussi, sont imprégnées d’une certaine culture du silence ?
Par culture de silence, nous faisons référence à un corpus d’idées ou de traditions, verbalisées ou non, intériorisées par les membres d’un groupe, au point où la parole de ceux-ci est entravée et confinée à l’intérieur du groupe. En ce qui concerne nos assemblées, nous cherchons à comprendre pourquoi la parole des victimes de violences conjugales est restée si longtemps inaudible.
Le silence du déni
Dans son discours cité plus haut, le Premier ministre a évoqué le déni de la société française face aux violences conjugales comme une « incapacité à regarder cette horreur en face ». Les violences conjugales ne connaissent pourtant pas de frontières. Elles ne s’arrêtent pas à la porte de nos communautés, qui cependant ont longtemps fait comme si elles étaient imperméables à cette réalité sociétale. Ce faisant, nous avons laissé croire que celles-ci ne concernaient pas les foyers chrétiens. Si les ouvrages de préparation au mariage abordent presque toujours les thèmes relatifs à la communication et à la gestion des conflits, force est de constater que la réflexion autour de la violence d’une manière générale est occultée. Les agressions dans le couple, certes plus médiatisées aujourd’hui, sont pourtant présentes au sein des foyers, y compris des chrétiens. Comment expliquer que nous nous soyons moins préoccupés de cette question, tandis que des prédications sur la sexualité préconjugale et le divorce ont parfois saturé l’espace d’enseignement dans nos assemblées ?
Un chrétien, homme ou femme, qui n’entend jamais parler de la maltraitance au sein du couple tout au long de son cheminement au sein d’une communauté, finit par intérioriser l’idée que cette réalité n’existe pas pour les chrétiens. Dès lors, comment parler de ce qui ne devrait pas exister dans ce milieu ? C’est ainsi que se construit le déni, cette protection illusoire.
Le linge sale se lave en famille
L’importance que nous accordons au développement des relations fraternelles est une qualité de nos assemblées. La métaphore biblique de l’Église comme famille de Dieu colle bien à la réalité du vécu des communautés évangéliques. Les relations fraternelles y sont significatives, parfois même plus importantes qu’avec les membres de nos familles humaines. Le revers de la médaille, c’est la dérive de l’entre-soi qui n’est jamais loin.
L’idée que le « linge sale se lave en famille » est symptomatique de cette logique insulaire. Elle trouve un terreau très propice dans des milieux évangéliques où l’on considère par exemple que les agressions, telles les violences conjugales, lorsqu’elles impliquent des chrétiens, devraient être gérées uniquement au sein de l’assemblée. La peur du scandale vis-à-vis du monde, nourrit la logique autarcique qui conduit ordinairement à une gestion interne des maltraitances, au risque d’aggraver l’état des victimes.
3. Confondre conflit et violence est préjudiciable aux femmes
Il arrive que les conflits au sein d’un couple dégénèrent en violences verbales, psychologiques, économiques, physiques. Il est important, lorsqu’ils ont connaissance de ces situations, que les responsables ne confondent pas conflit et violence.
Étymologiquement, le mot conflit dérive du substantif latin conflictus qui signifie heurt, choc, affrontement. Ce heurt résulte de désaccords relatifs aux biens, aux objets, aux intérêts ou aux personnes, qu’elles soient morales ou physiques.
Dans le cadre de personnes physiques, Frédéric Rognon parle d’un « désaccord vécu comme un rapport de forces […]. Un conflit n’est donc pas un simple désaccord, mais un désaccord qui périclite au point de devenir facteur de tensions et d’oppositions. »
Dans le foyer, mari et femme sont en principe dans une relation égalitaire que le désaccord ne remet pas en question. Le conflit sera, suivant sa gestion par le couple, soit porteur de positivités soit porteur de négativités. C’est là toute l’ambivalence du conflit ou plus exactement de la gestion d’un conflit. Un désaccord bien géré peut être pour les époux une opportunité permettant des réajustements heureux susceptibles de réorienter positivement la dynamique conjugale. Une mésentente mal gérée risque de mettre à mal la dynamique relationnelle dans le foyer et même de dégénérer en agressions. Mais alors, qu’est-ce qui distingue le conflit de la violence ?
D’une manière synthétique, Frédéric Rognon définit la violence comme « la négation de l’autre ou de soi-même en tant que personne humaine, en tant qu’être pourvu de dignité […]. La violence est donc l’instrumentalisation de l’autre ou de soi-même, sa réduction à un moyen, au lieu de le considérer comme une fin en soi. »
Elle est donc tout ce qui aliène la dignité de l’autre en portant atteinte à son intégrité physique, sexuelle, psychologique, et morale. Notre rapport immédiat à la violence a tendance à la réduire à sa seule dimension physique, quand il y a des coups, des blessures, des fractures, bref tout ce qui laisse des traces et des marques sur le corps qui permettent de remarquer/constater les sévices. Une telle vision est restrictive parce qu’elle passe à côté des autres formes de maltraitances, plus difficiles à détecter, puisqu’elles ne nous sautent pas immédiatement aux yeux. C’est le cas des violences psychologique, structurelle et symbolique.
Les violences conjugales ne peuvent s’inscrire dans le cadre de la médiation, qui suppose un positionnement égalitaire des protagonistes, ce qui est fondamentalement le contraire dans les maltraitances commises par le mari. Celles-ci surviennent le plus fréquemment parce qu’il (lui ou un ex) dénie à son épouse cette égalité et se maintient dans une position haute, de domination, pour exercer une emprise et un contrôle sur sa femme, généralement d’ailleurs en refusant la séparation.
Il convient de rappeler que la médiation familiale s’inscrit dans le cadre général des séparations familiales. Sa visée première n’est donc pas la réconciliation des époux, mais l’élaboration commune et paritaire, avec l’aide d’un tiers professionnel, d’objectifs partagés par deux personnes qui ne sont plus, ou ont déjà décidé de ne plus être, liées par le lien conjugal. Par exemple, les époux ont décidé de saisir la justice pour divorcer, mais les deux souhaitent agir dans l’intérêt commun de leurs enfants et ont besoin de l’aide d’un médiateur familial pour les accompagner dans cette démarche.
De l’avis de nombreux spécialistes : « La médiation dans les situations de violences conjugales est une solution qui maintient le problème ou l’aggrave, car elle nécessite la mise en place d’un dispositif qui replace la victime en présence de son agresseur, et donc en position de soumission : elle tend à rendre interactive la responsabilité de l’acte violent, à donner à la victime une part de responsabilité dans cet acte, et à privatiser ou minimiser la nature délictuelle ou criminelle des violences conjugales. »
La médiation n’est donc pas une panacée. Sa mise en œuvre au sein d’une assemblée par des personnes non professionnelles est extrêmement problématique, et ajoute à la confusion courante entre conflit et violence. Cette confusion est très préjudiciable aux femmes maltraitées.
Face à une victime, il est important que le pasteur affirme clairement que, quelle que soit les formes qu’elle prend, la violence est un acte grave, interdit et répréhensible par la loi. Ce n’est pas parce qu’une maltraitance ne se voit pas physiquement qu’elle n’en est pas une. Il est vrai que les pasteurs ne sont pas toujours au courant des agressions dissimulées dans le cadre domestique, et parfois même cachées par les femmes. Cela s’explique entre autres, par l’intériorisation de la violence symbolique chez la plupart d’entre elles. Elles pensent qu’elles ne sont pas aimables, qu’elles ne valent rien, qu’elles sont nulles, qu’elles méritent les coups.
Mais dès lors qu’ils ont connaissance d’insultes, d’humiliations, même si le passage à l’agression physique n’a jamais eu lieu, les responsables doivent nommer cette violence et clairement la condamner. Une femme a besoin d’entendre que les insultes, les humiliations, les privations, le harcèlement moral, sont des actes graves, violents, injustifiables et légalement répréhensibles. Une femme qui subit des sévices est une personne en danger de mort. Elle a besoin de savoir qu’elle doit impérativement se protéger et on doit l’encourager à porter plainte contre son mari (ou son ex) qui la brutalise.
Malheureusement, les victimes, au motif qu’elles sont chrétiennes, sont ordinairement dissuadées, ici et là, de porter plainte contre leur mari. Cette interdiction est-elle bibliquement fondée, comme on l’entend parfois dire ?
4. L’interdit du recours à la justice des hommes
A l’appui de cette interdiction à saisir les tribunaux pour régler les différends entre chrétiens, on convoque souvent 1 Corinthiens 6,1ss. Voici les cinq premiers versets d’après la version Nouvelle Français Courant (2019) :
« 1 Quand l’un de vous entre en conflit avec un frère ou une sœur, comment ose-t-il demander justice à des juges païens au lieu de s’adresser aux membres de l’Église ? 2 Ne savez-vous pas que ceux qui appartiennent à Dieu jugeront le monde ? Et si vous devez juger le monde, êtes-vous incapables de juger des affaires de peu d’importance ? 3 Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? À plus forte raison les affaires de cette vie ! 4 Or, quand vous avez des conflits pour des affaires de ce genre, vous prenez comme juges des gens qui ne comptent pour rien dans l’Église ! 5 Je le dis à votre honte. Il y a sûrement parmi vous au moins une personne sage qui soit capable de régler un conflit entre frères et sœurs ! »
La nécessité de resituer la réaction de Paul dans le contexte de l’Église de Corinthe
Dans la société corinthienne, aller en procès était, semble-t-il, un signe de prestige social qui permettait d’asseoir son rang et sa réputation, à condition de gagner. Ceux qui étaient en mesure de se payer un procès coûteux n’hésitaient donc pas à saisir la justice. Compte tenu du statut social des membres de l’Église de Corinthe (1,26), seulement quelques chrétiens aisés pouvaient assumer financièrement une telle démarche. Mais comment comprendre la réaction de l’apôtre Paul, très choqué d’apprendre qu’un croyant ayant un litige contre un autre a porté l’affaire devant les tribunaux civils ?
D’abord parce que le litige en question est une affaire de faible importance qui aurait pu se régler au sein de l’Église. L’apôtre ne relativise pas ces injustices, il ne souhaite pas non plus taire les conflits qui éclatent entre les fidèles, mais il s’indigne d’abord ici de ce que l’Église soit incapable d’arbitrer des différends mineurs.
Ensuite, l’apostrophe de Paul à travers une double question rhétorique (v.2-3), met en évidence, et de manière nettement contrastée, la défaillance des Corinthiens. L’apôtre ne comprend pas que ceux qui seront associés au jugement du monde et même des anges, ne soient pas en mesure, a fortiori, de juger les affaires de la vie ! C’est donc principalement cette faiblesse de l’Église, son incapacité à rendre la justice qui fait réagir Paul. Le laisser-faire qui prévaut dans cette communauté de croyants montre son affaiblissement.
Enfin, l’apôtre est soucieux du témoignage de l’Eglise. Il redoute qu’en allant devant les tribunaux des païens, les chrétiens de Corinthe, davantage soucieux de leur fierté ou de leur prestige social, contribuent à disqualifier le témoignage pour Christ.
La question de fond est de savoir si la position de Paul ici s’applique à tous les conflits entre chrétiens. Autrement dit, ne faut-il pas différencier les situations ?
L’importance d’une prise en compte différenciée des problèmes
Quelle est la nature du différend dont il est question dans ce passage ? L’apôtre emploie deux mots grecs pour évoquer ce litige. Le premier est pragma que l’on trouve dans plusieurs autres passages du Nouveau Testament. Le second terme biotika, traduit par « les affaires de la vie courante », désigne fréquemment ce qui est nécessaire au maintien de la vie humaine, et plus précisément les affaires économiques.
Le démêlé en question ici est donc certainement un problème d’argent entre deux chrétiens, qui font peut-être partie de la minorité des privilégiés de l’assemblée de Corinthe. Pour Paul, ce type de désaccord relève de la catégorie des « choses de la vie » que la communauté aurait dû arbitrer. Car il s’agit selon lui de jugements de faible importance.
Ceux qui voudraient interdire aux épouses brutalisées de recourir à la justice humaine considèrent-ils que ce sont des « affaires de la vie courante » appelant un jugement de faible importance ? Espérons que non ! Il est donc nécessaire de différencier les situations, car toutes ne sont pas d’égale gravité.
D’ailleurs l’apôtre le montre très bien. Au chapitre précédent, au sujet de l’inceste, alors que la communauté a laissé impunie cette faute (c’est un déni d’amour fraternel et un déni de justice), il montre qu’il ne s’agit pas d’un banal problème et souligne que l’acte incestueux, qualifié de « porneïa »est grave et appelle une réponse de l’Église. Et cette réponse prononcée par la congrégation/assemblée réunie, au nom du Seigneur, et suivant la recommandation de l’apôtre, sera l’exclusion du fauteur. Ainsi conclut-il en 5,13 : « Chassez le méchant du milieu de vous », une citation de Deutéronome 13,6 ou 17,7 où il est même question de mise à mort des prétendus prophètes et des idolâtres.
Il y a donc des situations où l’Église en tant que corps de Christ devrait avoir le courage de prendre pleinement sa responsabilité en se dressant contre le méchant. C’est une décision aussi douloureuse que d’accepter l’amputation d’un membre lorsque la gangrène menace tout le corps. La gravité de la porneïa vient effectivement rompre une alliance fraternelle. Dans un autre contexte, Jésus affirmera que la porneïa est une faute grave qui atteint le lien entre les époux, au point que l’un des deux envisage que l’alliance conjugale est de facto rompue. C’est la fameuse « clause d’exception » matthéenne (Mt 5,31-32 ; 19,9) qu’il ne faudrait d’ailleurs pas considérer comme le seul motif légitime de rupture du lien entre les conjoints. En 1 Corinthiens 7, Paul envisage une rupture de l’alliance conjugale non relative à la porneïa.
Il y a d’autres situations pour lesquelles, nous semble-t-il, l’Église est appelée à penser d’abord aux victimes et à les encourager à saisir la justice des hommes, qui fait d’ailleurs partie des institutions que nous sommes appelés à respecter. Paul lui-même, soulignant l’importance de la soumission aux autorités, rappelle que : « Les magistrats ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. […] Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. […] En effet, ce n’est pas pour rien qu’il porte l’épée, puisqu’il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. » (Rom 13.3-4).
Si dans le cas des litiges financiers, Paul a invité des chrétiens à renoncer à leurs droits par souci pour le témoignage de l’Église, cela ne veut pas dire qu’il voulait ériger cette attitude en loi universelle.
Nous rejoignons Robert Somerville quand il affirme que :
« Des cas peuvent se présenter où pour protéger le faible ou le spolié, ou pour éviter d’encourager les malfaiteurs, l’application du principe de rétribution est une expression de l’amour, même si cela implique qu’on fasse appel à la justice des hommes. Devant certaines fautes qui peuvent ruiner la vie de ceux qui en sont victimes (on peut penser par exemple aux abus sexuels ou au chantage avec extorsion de fonds), il serait injuste de se taire et de ne pas porter l’affaire devant les magistrats. »
Il y a donc une violente injustice et un authentique contre-témoignage à vouloir faire taire les victimes de violences conjugales ou à vouloir les dissuader de saisir la justice des hommes.
Paul lui-même, certes dans un autre contexte, n’a pas hésité à saisir les moyens légaux dont il disposait en tant que citoyen romain, en faisant appel à l’empereur (Ac 25,10-11). Les épouses maltraitées ont le droit, même lorsque leur mari est chrétien, de saisir tous les moyens légaux à leur disposition pour mettre une limite au méchant, et pour rétablir la justice. Or, plutôt que de les accompagner dans ce sens, on les soumet à d’autres injonctions, comme le fameux « il faut pardonner ». Des commandements qui leur sont préjudiciables, comme nous le verrons.
5. L’injonction d’un pardon bon marché
S’il y a un lieu où le pardon est une valeur importante, c’est bien au sein de l’Église. Jésus n’a-t-il pas enseigné à ses disciples à pardonner aux autres leurs offenses comme le Père pardonne les leurs ? (Mt 6,12). L’offensé n’est-il pas invité à prendre l’initiative d’une démarche visant à gagner l’offenseur ? (Mt 18,15-20) Jésus ne nous invite-t-il pas à être toujours disposés à pardonner notre prochain, sans tenir une comptabilité au sujet de ses fautes ? (Mt 18,21-35). On s’attend donc à ce que dans chaque communauté le pardon et la réconciliation soient concrètement vécus.
Mais cette attente justifie-t-elle les ordres de pardonner, que l’on assène aux personnes blessées, meurtries par les agressions graves qu’elles ont subies ?
Il est intéressant de remarquer que Matthieu 18, où Jésus enseigne sur le pardon, commence par une question de place (de pouvoir ?), à laquelle il répond en attirant d’abord l’attention de la communauté des disciples sur le plus vulnérable des membres de la société, un petit enfant. En opérant un renversement, il commence par rappeler que l’accès au Royaume suppose une métanoïa, un changement de mentalité pour devenir comme ces tout petits. Il s’agit de s’engager volontairement à renoncer à notre désir de puissance, de domination, pour entrer dans un apprentissage d’humble confiance et de dépendance vis-à-vis de Jésus, comme un très jeune enfant. Il est significatif de noter que le modèle du disciple de Jésus nous est donné en « ces petits qui croient en moi » (Mt 18,6), mais non pas en ceux qui placent leur confiance dans leur désir de toute-puissance et de domination.
L’enseignement sur le pardon est précédé par une mise en garde à quiconque causerait le trébuchement d’un seul de « ces petits qui croient en moi ». On n’a peut-être pas assez insisté sur la gravité avec laquelle le Christ a dénoncé en Matthieu 18,6ss les scandales qui ébranleraient ces « petits » qui se confient en lui :
« Mais quiconque entraîne la chute d’un seul de ces petits qui croient en moi, il est préférable pour lui qu’on lui attache au cou une grosse meule et qu’on le précipite dans l’abîme de la mer. […] Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car, je vous le dis, aux cieux leurs anges se tiennent sans cesse en présence de mon Père qui est aux cieux. » (TOB 2010)
Nous méprisons les victimes de violences conjugales lorsque nous ne dénonçons pas le scandale qui a causé leur effondrement. Nous méprisons leur souffrance, lorsque nos paroles se résument à des injonctions à pardonner : « tu dois lui pardonner », « il faut laisser la porte ouverte », « tu ne peux pas avancer en gardant cette colère », etc. Ces commandements formulés par des croyants qui pensent bien faire, aggravent en fait la souffrance des femmes maltraitées qui ont le sentiment de ne pas être de « bonnes chrétiennes » parce qu’elles ne sont pas encore en mesure de pardonner l’offense, les agressions/les sévices subi(e)s. Plus grave encore, ces ordres de pardonner dévoilent généralement une mécompréhension du pardon biblique.
La démarche enseignée par Jésus en Matthieu 18 met en relief trois étapes. A chaque étape, l’objectif est de « gagner un frère. » Le passage est lui-même inséré entre la parabole dite de « la brebis perdue et retrouvée » et la question de Pierre au sujet du pardon. Si Jésus n’entre pas dans une logique comptable du pardon, il ne nous propose pas non plus un pardon au rabais.
Le pardon n’est pas du domaine de l’injonction, mais s’inscrit dans le registre de la grâce, dont le fondement est en Dieu lui-même. C’est parce que Dieu nous a pardonnés le premier, et qu’il nous a réconciliés avec lui en Jésus-Christ, que nous sommes à notre tour appelés à pardonner notre prochain et à vivre en paix avec lui, autant que cela dépende de nous.
Le pardon biblique comporte une dimension juridique, qui établit légalement la réalité qu’une « dette », c’est-à-dire une offense, a été remise à l’offenseur par la personne offensée : « Pardonner, c’est avant tout remettre la dette ou la faute de l’offenseur. […] C’est un acte de pure grâce, d’amour immérité. » Ce qui ne veut pas dire que cette grâce est inconditionnelle.
En effet, le pardon selon la Bible suppose une repentance sincère de la part de l’offenseur. Dieu lui-même promet de nous pardonner, si nous revenons de nos mauvaises voies (Jér 36,3). Il ne désire pas la mort du méchant, mais veut qu’il change de conduite et qu’il vive (Ez 33,11). Le modèle divin du pardon implique la nécessité de la repentance de l’offenseur, et c’est aussi vrai en ce qui concerne le pardon entre les êtres humains.
Sans une repentance sincère du coupable, le pardon biblique serait galvaudé. Ce serait un pardon à bon marché qu’il nous faudrait dénoncer, comme Dietrich Bonhoeffer s’était insurgé contre une grâce à bon marché. Exhorter une victime à pardonner à son bourreau sans repentance sincère de ce dernier, c’est minimiser la réalité de l’offense, c’est donner raison à l’offenseur et tort à l’offensé, c’est donc nier la victime et faire peu de cas de sa souffrance. Or les femmes qui sont brutalisées par leur conjoint ont besoin d’être d’abord entendues et reconnues comme victimes. Elles ont besoin que les sévices qu’il leur a fait subir soit nommés, reconnus, et que leur mari soit considéré seul responsable des agressions commises.
Sous prétexte qu’un conjoint violent a reconnu ses fautes et demandé pardon, on a tendance à considérer trop facilement que l’épouse, parce qu’elle est chrétienne, devrait être en mesure de pardonner et de se réconcilier. Certains iront jusqu’à l’encourager à arrêter ses démarches judiciaires, à retirer ses plaintes ! C’est une erreur grave, d’une part parce que l’on ne respecte pas sa liberté et que l’on ne prend pas suffisamment en compte sa souffrance ; et d’autre part, parce que l’on confond pardon et réconciliation et que de surcroît l’on oppose les deux à la notion de justice. Or comme l’a bien vu Guilhem Causse :
« Le pardon, loin de s’opposer à la justice demande de l’honorer : il n’est pas l’effacement des fautes. […] Le pardon apparaît enfin en pleine lumière, comme ce qui était à l’œuvre dès le début, dans l’attention aux petits, la dénonciation du scandale, dans le long et difficile chemin avec les personnes victimes jusqu’à leur relèvement, l’interpellation courageuse des coupables, sans relâche, ouvrant à la justice et à leur repentir. Le pardon est cette force et cette parole qui fondent et défendent chacun de nous et notre fraternité contre ce qui la menace, d’abus et de silence. Il est ce qui peut nous maintenir en humanité, chacun et ensemble, malgré tout, jusqu’au bout. »
Nous n’avons donc surtout pas à exiger des femmes maltraitées qu’elles pardonnent ! Ce serait une violence supplémentaire. Mais nous devons d’abord dénoncer le scandale dont elles sont victimes, reconnaître leurs blessures, accompagner leur relèvement et leur cheminement, dans le respect de leur rythme et de leur parole. Peut-être alors, seulement, parleront-elles pour pardonner. Encore faudrait-il que leur tortionnaire se soit réellement repenti, ce qui est extrêmement rare.
Conclusion : Devant le Seigneur, il n’y a pas l’homme sans la femme ni la femme sans l’homme.
La médiatisation contemporaine des violences conjugales a participé à l’émergence d’une prise de conscience nouvelle au sein de notre société comme au sein des assemblées évangéliques. Le seuil de tolérance et d’accommodation aux injustices dont les femmes sont les premières victimes (sans oublier les enfants), est de plus en plus bas. Ce qui hier semblait tolérable est aujourd’hui, heureusement, légalement sanctionné et socialement stigmatisé comme injustifiable. Les églises apprennent humblement à balayer dans leur maison et devant leur porte. Beaucoup reste à faire pour changer les mentalités, prévenir les abus, aider les victimes à se relever, et inciter le bourreau à abandonner sa méchanceté en l’orientant vers des professionnels du soin.
Dans cette perspective, la formation des responsables d’Église est essentielle à moult égards. Tout d’abord, beaucoup de ces responsables méconnaissent les mécanismes des violences conjugales, les modes opératoires des auteurs, l’impact des maltraitances sur les épouses. Il est donc nécessaire qu’ils soient informés et formés pour mieux appréhender ce phénomène, afin d’agir en amont, en prévenant et en détectant ces situations.
Il y a ensuite la question de l’accompagnement des victimes. Autre enjeu de la formation. Certes, tous les responsables d’Églises ne sont pas en mesure d’accompagner des femmes brutalisées, mais tous peuvent être encouragés à se former, notamment à « l’écoute bienveillante ». Nous l’avons signalé, nombreuses sont les femmes qui souffrent de n’avoir pas été vraiment écoutées par les responsables de leur assemblée. Nos communautés doivent penser à créer des cadres sécurisés où elles seront non seulement entendues, mais écoutées.
Enfin, dans les assemblées caractérisées par le biblicisme évoqué plus haut, la question du rapport aux Écritures demeure fondamentale. Nous l’avons vu, l’interprétation biblique n’est pas une démarche neutre, et dans certains cas elle risque d’aggraver la souffrance des victimes. Il ne suffit donc pas de professer le Sola Scriptura hérité de la Réforme. Mais encore nous faut-il questionner l’orientation de notre herméneutique : sa visée est-elle celle d’une fidélité à la lettre qui tue, ou celle d’un discernement de l’Esprit qui fait vivre (2 Cor 3.6) ?
Nous avons besoin d’une authentique métanoïa pour sortir de la mentalité du déni, rompre avec nos silences et notre inaction coupables, rechercher la justice pour les victimes sans laquelle le pardon serait une grâce dévoyée. Une métanoïa qui nous oriente vers Jésus. C’est lui, Jésus, le critère objectif de tout discernement authentique de la volonté de Dieu, le Père, qui, dès le commencement, a voulu que « l’homme ne soit pas sans la femme ni la femme sans l’homme » (1 Cor 11.11). Par son attitude à l’égard des femmes, tout au long de son ministère terrestre, Jésus nous révèle davantage que sa liberté par rapport au contexte culturel de son époque. Il nous montre qu’il est aussi venu restaurer cette relation originelle qui lie ish et isha (Gen 2.22-24), également créés à l’image de Dieu, bénis pour être l’un par l’autre porteur de fécondités, mandatés ensemble comme co-gérants de la Création.
Briser le cercle vicieux du péché qui pervertit la différence homme-femme en la transformant en lieu de domination et de négation de l’altérité, n’est-ce pas une mission proprement chrétienne pour nos Églises, dans un contexte français où une femme est tuée tous les deux jours et demi par son conjoint ou son ex-conjoint ?